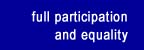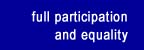Download Version: Word | PDF
Rapport du Rapporteur spécial de la
Commission du développement social sur le suivi de l'application des
Règles pour l'égalisation des chances des handicapés sur son troisième
mandat (2000-2002)
Annexe :
À l'écoute des plus vulnérables : projet de supplément
aux Règles pour l'égalisation des chances des handicapés
E/CN.5/2002/4 (Retour au rapport)
I. Introduction
1. Les politiques et
les législations relatives aux handicapés ont plus progressé pendant les années 90 que
lors des décennies précédentes. Ces avancées sont le fruit des activités liées à la
célébration de l'Année internationale des personnes handicapées (1981) et à
l'adoption du Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées
(A/37/351/Add.1 et Add.1/Corr.1, annexe, sect. VIII) et des initiatives menées tout au
long de la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées (1983-1992).
2. Depuis leur
adoption par l'Assemblée générale dans sa résolution 48/96 du 20 décembre
1993 (annexe) et la création de leur mécanisme de suivi en 1994, les Règles pour
l'égalisation des chances des handicapés ont eu un rôle important à jouer à travers
le monde dans l'élaboration de politiques et de législations nationales relatives aux
handicapés. Leur application pratique et dynamique a permis de dégager de nouveaux
enseignements qui serviront à déterminer leurs modalités d'utilisation futures. On a pu
déceler au passage certaines imperfections et lacunes dans le texte en vigueur.
3. Tout au long des
Règles, le terme « handicapés » qualifie des personnes de tous âges
souffrant d'un handicap. Dans le texte du projet de supplément, le terme s'étend
systématiquement aux « garçons, filles, hommes et femmes handicapés »
lorsqu'on ne lui attribue pas d'autre sens.
4. Le projet de
supplément aux Règles a pour objet de compléter et d'enrichir le texte existant dans
certains domaines. Ce travail s'appuie sur une étude des imperfections et des lacunes des
dispositions actuelles que le Rapporteur spécial sur la situation des handicapés a
présenté à la Commission du développement social à sa trente-sixième session
(E/CN.5/2000/3, annexe). Dans cette étude, le Rapporteur spécial a accordé une
attention particulière aux points suivants : la parité homme-femme; les questions
relatives au logement et à la communication; les besoins des enfants et des personnes
âgées; les besoins des personnes handicapées mentales et des malades mentaux; et les
besoins des handicapés touchés par la pauvreté.
5. Pour
l'élaboration du présent supplément, on a recherché le concours de plusieurs
organisations internationales et experts, en particulier de ceux qui représentaient les
intérêts des personnes handicapées mentales et des malades mentaux et les intérêts
des enfants. Le groupe d'experts chargé de l'examen du mécanisme de suivi des Règles a
travaillé sur le texte et formulé de nombreuses suggestions utiles. Enfin, il a été
tenu compte des résultats de la conférence internationale organisée par l'Organisation
mondiale de la santé sur le thème « Repenser les soins dans la perspective des
personnes handicapées » (Oslo, 22-25 avril 2001) en coopération avec le
Gouvernement norvégien.
6. Le présent
supplément ne s'articule pas comme les Règles. Ses sections ont été ordonnées de
façon à éviter toute répétition inutile. Il se présente tour à tour sous la forme
de commentaires et d'explications du texte existant et contient une série de
recommandations organisées selon le même schéma que dans les Règles.
7. On constatera
d'emblée que les commentaires et les recommandations figurant dans le présent
supplément concourent à souligner les besoins des adultes et des enfants handicapés les
plus vulnérables.
Haut de page
II. Projet de supplément aux Règles
A. Notions fondamentales
8. Les Règles citent
la Classification internationale des handicapés : déficiences, incapacités et
désavantages adoptée par l'Assemblée mondiale de la santé de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) en 1980. Cette classification a été révisée depuis. En 2001,
l'Assemblée mondiale de la santé a approuvé la Classification internationale du
fonctionnement, du handicap et de la santé qui appréhende les fonctionnalités et les
handicaps dans un contexte se caractérisant par des facteurs individuels et des facteurs
environnementaux physiques, sociaux et liés au comportement. Les états fonctionnels et
les handicaps sont classés par référence aux fonctions organiques, à la personne en
tant qu'individu et à la personne en tant qu'être social. La Classification peut être
utilisée pour décrire la capacité d'un individu à s'acquitter d'actes de divers
degrés de complexité et de déterminer en conséquence les interventions sanitaires et
autres à même d'influer sur les activités de la personne. En outre, la classification
peut servir à décrire le comportement d'un individu dans son cadre de vie. On peut ainsi
identifier les facteurs environnementaux qui lui facilitent ou lui compliquent la tâche
et déterminer les aménagements à apporter à l'environnement ou les soins de santé à
dispenser à l'intéressé pour élargir ses perspectives. On notera toutefois que le
présent supplément s'aligne sur la terminologie utilisée dans les Règles pour
prévenir toute confusion.
9. Il convient de
noter que l'utilisation du terme de « handicap » prête beaucoup à confusion.
Bien que ce terme existe dans de nombreuses langues, il a acquis des connotations
péjoratives, négatives, voire même injurieuses dans plusieurs d'entre elles, et doit
donc être manié avec la plus grande précaution.
10. On soulignera aussi que le terme de
« prévention », tel que défini dans les Règles, ne doit jamais être
avancé pour justifier le déni du droit des handicapés à la vie ou à la participation
à la vie sociale dans des conditions d'égalité.
B. Maintien d'un niveau de vie décent et atténuation de la pauvreté
11. Il est manifeste que dans les pays
en développement comme dans les pays développés, les handicapés et leur famille ont
plus de chances de vivre dans la pauvreté que le reste de la population. Ce phénomène
est vrai dans les deux sens : on risque davantage d'être pauvre si l'on est
handicapé et d'être handicapé si l'on est pauvre. Les préjugés et le regard négatif
de la société pèsent sur l'existence des enfants et des adultes handicapés et les
vouent à l'isolement et à l'exclusion de la vie de leur communauté.
12. Le maintien des handicapés à un
niveau de vie décent figure en substance dans le principe de l'égalité de droits pour
tous et dans le processus d'égalisation des chances des handicapés.
13. Les États devraient s'assurer que
les handicapés reçoivent l'appui dont ils ont besoin dans les infrastructures sociales
ordinaires, comme l'éducation, la santé, l'emploi et les services sociaux.
14. Au moment d'adopter des mesures de
lutte contre la pauvreté, les États devraient prévoir des programmes tendant à
faciliter l'autonomisation des handicapés et à promouvoir leur participation active à
la vie sociale.
15. Dans le cadre de leurs programmes
de développement, les États devraient aussi veiller à ce que les handicapés disposent
d'un logement décent et sûr, d'une alimentation de bonne qualité nutritive, d'eau
potable et de vêtements.
16. Dans le cadre des services
communautaires, les États devraient fournir aux handicapés des services d'éducation et
de réadaptation, les appareils remédiant à leur handicap et une aide à l'emploi.
17. Les États devraient encourager la
collecte et la diffusion de données sur les conditions de vie des handicapés et
promouvoir des travaux de recherche approfondis sur tous les facteurs qui influent sur la
vie des handicapés.
18. En coopération avec les autorités
locales et régionales, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
et d'autres acteurs, les États devraient apporter l'assistance nécessaire aux sans-abri,
aux personnes déplacées et aux réfugiés handicapés, en leur donnant les moyens de se
prendre en charge et en favorisant les solutions durables à leurs problèmes.
19. Les organisations d'handicapés
devraient être consultées à toutes les étapes des programmes touchant le niveau de vie
des handicapés.
C. Le logement, y compris la question des établissements spécialisés
20. Pour être des citoyens à part
entière, dans des conditions d'égalité, les handicapés doivent impérativement
grandir, vivre et réaliser leur potentiel dans la communauté à laquelle ils
appartiennent. Il est capital à ce titre qu'ils disposent d'un logement décent.
21. Les États devraient veiller à
fournir à tous les handicapés des logements et des structures d'accueil sûrs,
habitables, accessibles et bon marché qui soient adaptés à leur état de santé et à
leur confort. Ces logements, infrastructures sociales et physiques y comprises, devraient
permettre aux enfants handicapés de grandir avec leurs parents et aux adultes handicapés
d'avoir leur place dans la communauté.
22. Au rang des mesures adoptées
devraient aussi figurer des campagnes de sensibilisation pour lutter contre les attitudes
négatives des voisins et de la population locale.
23. Dans les pays où l'on a eu
jusqu'ici pour politique de loger de nombreux groupes d'handicapés dans de gros
établissements indépendants, les États devraient plutôt opter pour les services
communautaires et l'aide familiale. Ils devraient ainsi pouvoir entamer des programmes
permettant de mettre fin aux admissions dans ces établissements et d'en planifier la
fermeture à terme.
24. Pour les orphelins en situation
d'handicap et pour les autres groupes d'enfants handicapés sans famille ni autre soutien
individuel, on devrait trouver des familles d'accueil. Pour les adultes se trouvant dans
la même situation, de petites infrastructures de type familial (foyers) implantées dans
la communauté devraient se substituer aux gros établissements.
25. Les États devraient veiller à ce
qu'un soutien approprié soit fourni aux handicapés en établissement lorsqu'ils quittent
les centres spécialisés pour rejoindre la collectivité et que des services
d'accompagnement continuent de leur être offerts aussi longtemps que nécessaire.
26. S'agissant des personnes vivant
toujours en établissement, les États doivent s'assurer que leurs besoins fondamentaux
sont satisfaits et veiller au respect de leur droit à un espace privé où ils peuvent
recevoir des visites et conserver leurs archives, leur correspondance et autres effets
personnels. Le traitement prescrit à chaque personne devrait viser à préserver et
favoriser l'autonomie personnelle. Les États doivent aussi veiller à ce que des
possibilités soient offertes aux handicapés de participer utilement à la vie de la
collectivité.
D. Santé et soins médicaux
27. La santé constituant un droit
fondamental, les États doivent assurer l'accès à des services et des équipements
médicaux sûrs et de qualité à tous, quels que soient la nature et/ou le degré du
handicap, l'âge, le sexe, la race, l'origine ethnique ou les préférences sexuelles. Les
États devraient reconnaître que les handicapés ont le même droit à disposer
d'eux-mêmes que les autres citoyens, notamment le droit d'accepter ou de refuser un
traitement. Les États doivent veiller à ce que le droit à la vie prime dans le cadre
des prestations de services médicaux et sanitaires.
28. Les États devraient assurer que
les handicapés puissent accéder à des soins médicaux de même qualité que les autres
membres de la société et ne subissent pas de discrimination du fait de présomptions sur
leur qualité de vie et leur potentiel en tant qu'individu.
29. Les États devraient s'assurer que
tout le personnel médical, paramédical et connexe soit bien formé et équipé pour
fournir des soins aux handicapés et qu'ils disposent des moyens thérapeutiques et
technologiques nécessaires. Pour se faire une idée exacte du quotidien d'un handicapé,
les futurs administrateurs devraient rencontrer des personnes confrontées à ce problème
et s'inspirer de leur témoignage.
30. Le personnel médical et
paramédical devrait fournir aux handicapés des informations et des conseils détaillés
et objectifs sur le diagnostic et le traitement de leur handicap. C'est particulièrement
important dans les cas de diagnostic prénatal. Lorsque le sujet est un enfant, ces
informations devraient être communiquées aux parents et, le cas échéant, aux autres
membres de la famille.
31. Les États devraient élaborer et
exécuter des programmes en étroite collaboration avec des handicapés des deux sexes
afin d'offrir aux handicapés une éducation, une information et des services adaptés
d'une totale accessibilité qui répondent à leurs besoins en matière de reproduction et
de sexualité.
32. Les États devraient mener des
actions de sensibilisation aux maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida
et en assurer la prévention et le traitement.
33. Les États devraient veiller à ce
que le personnel et les services médicaux informent les handicapés de leur droit à
disposer d'eux-mêmes, y compris de la nécessité d'obtenir leur consentement en
connaissance de cause pour toute intervention, le droit de refuser les traitements et le
droit de ne pas se plier à une admission forcée à un établissement spécialisé. Les
États devraient aussi empêcher que des interventions médicales et apparentées et/ou
des interventions chirurgicales correctrices non consenties ne soient imposées aux
handicapés.
34. Les États devraient mettre au
point des programmes nationaux de réadaptation pour tous les groupes de handicapés. Ces
programmes devraient s'appuyer sur les besoins individuels réels des intéressés. La
formation devrait reposer sur les principes de la pleine participation et de l'égalité
des handicapés, et viser à la suppression des obstacles qui empêchent ces personnes de
prendre part à la vie ordinaire de la communauté.
E. Situations d'urgence
35. On a souvent constaté que les
programmes généraux de secours oubliaient ou négligeaient les besoins des handicapés.
36. En coopération avec les organismes
concernés des Nations Unies comme le HCR et le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), les États devraient mettre au point des politiques et des
directives en vue de la mise en place de mesures d'appui aux handicapés en situations
d'urgence. Les services d'urgence devraient être correctement équipés et préparés en
vue de la fourniture de soins médicaux et d'appui aux handicapés et à leur famille.
37. Il faudrait faire très attention
au fait que les handicapés sont parmi les premiers à subir des sévices dans les
situations d'urgence.
F. Accès au milieu social
38. Deux aspects de l'accessibilité
sont soulignés dans la Règle 5 des Règles pour l'égalisation des chances des
handicapés – l'accès au milieu physique et l'accès à l'information et à la
communication. L'expérience a prouvé qu'il était nécessaire de tenir compte de
l'accès au milieu social dans les programmes nationaux pour handicapés.
39. Les États devraient favoriser les
mesures visant à éliminer tous les obstacles induits par l'ignorance et les attitudes
négatives vis-à-vis des handicapés.
40. Un effort de lutte contre les
préjugés devrait être entrepris par le biais de campagnes publiques d'information et
d'éducation, de mesures de sensibilisation et d'incitation à une représentation plus
positive des handicapés dans les médias. L'accent devrait être mis sur la question de
la parité, les personnes handicapées mentales et les malades mentaux, les enfants
handicapés et les personnes souffrant de handicaps multiples ou invisibles.
41. Au moment de planifier des mesures
de lutte contre l'attitude négative de la société, il est particulièrement important
pour les États de s'assurer de la collaboration d'organisations d'handicapés.
G. Questions relatives à la communication
1. Technologies de l'information et de la
communication
42. Les technologies de l'information
et de la communication et l'infrastructure jouent, dans la fourniture d'informations et de
services, un rôle dont l'importance croît rapidement. Il faut donc les rendre
accessibles et mettre à profit les grandes possibilités qu'elles offrent d'aider et de
soutenir les handicapés.
43. Les États devraient faire en sorte
que les systèmes et services d'information et de communication offerts au public soient
accessibles d'emblée aux handicapés ou adaptés à cette fin. Il importe également de
donner aux handicapés la possibilité de suivre des cours de formation spéciaux,
notamment à distance, à l'aide de matériel informatique et, pour cela, d'acquérir du
matériel et des logiciels pour un coût raisonnable.
44. Les États devraient envisager de
subordonner l'octroi de fonds publics au respect de normes et de directives en matière
d'accessibilité et de facilité d'usage et considérer les marchés publics comme un
moyen d'assurer l'accessibilité.
45. Les États devraient prendre les
mesures nécessaires pour que soient élaborés et mis en place des dispositifs techniques
et juridiques spéciaux qui ouvrent l'accès des technologies de l'information et de la
communication aux handicapés.
2. Langage des signes
46. Au cours des années 90, les États
ont été de plus en plus nombreux à reconnaître que le langage des signes était un
moyen de communication essentiel pour les sourds. Vu l'importance décisive de ce langage
pour l'épanouissement des personnes entrant dans cette catégorie, il faut que cette
évolution se poursuive et soit encouragée dans le monde entier.
47. Les États devraient reconnaître
que le langage des signes est, pour les sourds, un moyen d'expression et de communication
naturel. Ce langage devrait être utilisé pour éduquer les enfants sourds, au sein de
leur famille et dans leur communauté.
48. Des services d'interprétation en
langage des signes devraient être prévus pour faciliter la communication entre les
sourds et le reste de la population.
3. Autres besoins en matière de
communication
49. Il faudrait prêter attention aux
besoins des personnes atteintes d'autres handicaps en matière de communication, telles
que celles ayant un défaut d'élocution, les malentendants, les sourds-aveugles et les
personnes souffrant de troubles du développement et de troubles mentaux, qui ont besoin
d'une assistance particulière.
50. En plus des technologies de
l'information et de la communication, il faudra peut-être, pour fournir cette assistance,
recourir à des appareils et accessoires fonctionnels et à des services d'interprète.
H. Formation du personnel
51. L'une des conditions indispensables
au bon fonctionnement des programmes et services destinés aux handicapés est qu'ils
doivent s'appuyer sur un personnel bien formé et informé. Dans la même logique, il
faudrait que certains groupes de professionnels au service de la population tels que les
médecins, les enseignants et les travailleurs sociaux soient mis au fait des handicaps et
des conditions de vie des handicapés lorsqu'ils reçoivent leur formation de base. Outre
que l'on devrait leur fournir des informations techniques, il faudrait les informer de la
manière dont les handicapés sont généralement perçus et traités.
52. Les États devraient faire en sorte
que toutes les autorités assurant la prestation de services à l'intention des
handicapés donnent à leur personnel une formation adéquate qui lui permette de
comprendre la teneur des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés.
53. Les États devraient faire en sorte
que ce personnel soit formé à reconnaître les actes de discrimination à l'égard des
enfants et des adultes handicapés qui sont fondés sur le sexe, l'appartenance ethnique,
la race, l'âge et/ou l'orientation sexuelle.
54. Les États devraient aider les
personnes atteintes de handicaps divers à acquérir une formation professionnelle ayant
un rapport avec les handicaps et à servir de modèles.
55. L'accès systématique des
personnes, groupes et institutions concernés par les handicaps à une formation continue
devrait être possible et encouragé.
I. Sexospécificités
56. Les femmes handicapées sont
souvent exposées à la discrimination à double, voire à triple titre, en tant que
femmes, handicapées et économiquement faibles.
57. Dans de nombreuses cultures, le
fait que ces femmes soient moins nombreuses que les autres à se marier et à avoir des
enfants a des incidences négatives sur leur condition. Elles sont souvent victimes de
discrimination en termes de soins médicaux et de réadaptation, d'éducation, de
formation professionnelle et d'emploi.
58. Le terme « handicapé »
qui est utilisé dans la première phrase de chacune des Règles devrait toujours
s'entendre des filles, garçons, femmes et hommes handicapés. Il importe, chaque fois
qu'il y a lieu, de souligner l'égalité entre les femmes et les hommes handicapés et de
rappeler que des enfants et des jeunes sont handicapés.
59. Dans les programmes de
développement soucieux d'équité entre les sexes, les femmes et les filles handicapées
devraient toujours figurer au nombre des bénéficiaires prioritaires.
60. Les organisations d'handicapés
devraient inscrire les problèmes des femmes et des filles handicapées à leur ordre du
jour et veiller à ce que les organisations de femmes et des organisations représentant
les enfants en fassent de même.
J. Les enfants handicapés et la famille
61. Dans certaines cultures, les
handicaps sont souvent considérés comme des châtiments et engendrent des sentiments de
peur et de honte. De ce fait, les enfants handicapés sont parfois mis à l'écart ou
négligés par la communauté dans laquelle ils vivent. Ils n'ont alors aucune
possibilité de vivre décemment et se voient d'ailleurs parfois dénier le droit à la
vie.
62. Les enfants handicapés sont
souvent ignorés par le système scolaire. L'architecture et l'agencement des écoles les
empêchent de se déplacer librement, de jouer avec les autres enfants et de rester en
leur compagnie.
63. Les États devraient prendre des
mesures qui permettent de détecter rapidement les handicaps et d'y remédier et faire en
sorte que les enfants handicapés, y compris ceux atteints de handicaps graves et/ou
multiples, aient accès à des services médicaux et de réadaptation. Ces services
devraient être dispensés sans distinction de sexe, d'âge ou de tout autre élément.
64. Les programmes de formation et de
réadaptation ne devraient pas empêcher les enfants handicapés d'exercer leur droit à
une vie familiale et à des relations sociales avec les enfants de leur âge qui ne sont
pas handicapés.
65. Tous les enfants handicapés, y
compris ceux qui le sont gravement, devraient recevoir une éducation. Une attention
particulière devrait être accordée à cet égard aux très jeunes enfants, aux filles
et aux jeunes femmes handicapées.
66. Les États devraient encourager
l'adoption de mesures qui permettent aux enfants handicapés de jouer avec les autres
enfants de leur communauté et de rester en leur compagnie.
67. Les États devraient veiller à ce
que les enfants, les adolescents et les jeunes atteints de handicaps puissent, compte tenu
de leur âge et de leur maturité, exprimer librement leurs vues sur les questions les
concernant et faire en sorte que ces vues soient prises en considération.
68. Les États devraient apporter un
appui adéquat aux familles ayant à charge un enfant handicapé, notamment en leur
fournissant une aide et des informations correspondant au handicap dont souffre cet
enfant, en leur permettant de bénéficier du même appui que celui fourni aux parents des
enfants non handicapés et en leur donnant la possibilité d'échanger des informations
avec d'autres parents.
69. Les États devraient encourager les
employeurs à prendre les mesures raisonnables nécessaires pour tenir compte des besoins
particuliers de ceux de leurs employés qui ont un enfant ou un adulte handicapé à
charge.
70. Les États devraient aider les
femmes et les hommes handicapés à se séparer de leur conjoint ou à en divorcer lorsque
celui-ci les maltraite ou les brutalise.
K. Violence et mauvais traitements
71. Des études réalisées ces
dernières années ont permis d'établir que les handicapés sont souvent victimes de
sévices sexuels et d'autres formes de violence et de mauvais traitements. Cet état de
choses est souvent difficile à déceler, les mauvais traitements en question pouvant
être commis à l'abri des regards et étant souvent dirigés contre des enfants et des
adultes qui ont du mal à s'exprimer.
72. Les États devraient élaborer des
programmes qui permettent de faire la lumière sur les mauvais traitements infligés aux
filles, garçons, femmes et hommes handicapés et d'y mettre un terme. Ces mauvais
traitements peuvent être infligés au sein de la famille, de la communauté et
d'institutions et/ou dans des situations d'urgence.
73. Il y a lieu d'apprendre aux
handicapés à éviter les mauvais traitements et à reconnaître et signaler ceux dont
ils sont victimes.
74. Les États devraient indiquer aux
handicapés les précautions qu'il doivent prendre pour éviter les sévices sexuels et
autres formes de mauvais traitements et fournir également ces informations à leur
famille.
75. Il faudrait apprendre aux
professionnels à reconnaître les conditions propices aux mauvais traitements, à
empêcher qu'il n'en soit commis, à déterminer quand une personne handicapée en est
victime, à lui venir en aide et à rendre compte des faits.
76. Il faudrait donner aux autorités
policières et judiciaires la formation et les instructions nécessaires pour qu'elles
puissent travailler avec les handicapés, recevoir leurs dépositions et s'occuper
convenablement des plaintes relatives aux mauvais traitements. Les auteurs de mauvais
traitements devraient être identifiés et traduits en justice.
77. Il y a peut-être lieu d'adopter
des mesures législatives spéciales pour protéger le droit des enfants et des adultes
handicapés à l'intégrité de leur personne et à l'intimité, afin d'éviter qu'ils ne
soient exploités et maltraités.
L. Personnes âgées
78. Les personnes âgées handicapées
se rangent dans deux grandes catégories : celles qui ont été handicapées
précocement – et dont les besoins évoluent parfois avec l'âge – et
celles dont le vieillissement dégrade les fonctions physiologiques, sensorielles ou
mentales. Compte tenu de l'augmentation de l'espérance de vie, due à l'amélioration
générale du niveau de vie, ce deuxième groupe s'accroît de plus en plus.
79. Les Règles n'établissant pas de
distinctions d'âge, le terme « handicapé » s'entend des personnes de tous
âges. L'expérience montre cependant que les politiques et programmes nationaux en faveur
des handicapés ne tiennent pas souvent compte des besoins des personnes âgées entrant
dans cette catégorie et il est donc peut-être utile d'apporter des précisions.
80. Les États devraient faire en sorte
que les politiques, programmes et services à l'intention des handicapés tiennent compte
des besoins des personnes âgées handicapées.
81. Une attention particulière devrait
être accordée aux besoins des personnes âgées handicapées dans la fourniture de
services et soins médicaux, de services de réadaptation, d'appareils et accessoires
fonctionnels et d'autres formes de services d'appui.
82. Il faudrait tenir compte de la
situation des personnes âgées handicapées dans les travaux de recherche, les activités
statistiques et l'étude des conditions de vie des handicapés.
83. Les campagnes d'information et de
sensibilisation devraient appeler l'attention sur la situation des personnes âgées
handicapées.
M. Handicaps résultant de troubles du développement et de troubles
mentaux
84. Les personnes atteintes de troubles
du développement et celles atteintes de troubles mentaux constituent deux groupes
distincts, vu l'origine et la nature de leurs problèmes, mais elles font partie des
groupes les plus vulnérables de la société car elles sont en butte à des comportements
et à des préjugés plus négatifs que la plupart des autres groupes de handicapés. Dans
les pays en développement et les pays en transition, en particulier, il est rare qu'elles
parviennent à faire entendre leur voix. Il en résulte que les plans visant à améliorer
les conditions de vie des handicapés restent souvent muets sur leurs besoins ou les
négligent.
85. L'une des plus grandes
insuffisances des Règles est qu'elles ne traitent pas de manière satisfaisante des
besoins des personnes atteintes de troubles du développement ou de troubles mentaux. Les
soins médicaux, la réadaptation, les services d'appui, les conditions de logement, la
vie familiale et l'intégrité de la personne, notamment, sont d'une importance vitale
pour ces personnes. La prise en compte de leurs besoins est un élément important des
nouvelles mesures proposées dans le présent document.
86. Les États devraient faire en sorte
que les besoins particuliers des personnes atteintes de troubles du développement ou de
troubles mentaux soient pris en compte en ce qui concerne les services médicaux, les
services de réadaptation et les services d'appui. Un accent particulier devrait être mis
sur les questions relatives à l'autonomie.
87. Les États devraient mettre au
point des formes d'appui aux familles qui ont à leur charge un enfant ou un parent
atteint de troubles du développement ou de troubles mentaux. La fourniture de ces formes
d'appui peut être nécessaire dans certains cas pour que cette personne puisse vivre avec
sa famille.
88. De nombreux adultes atteints de
troubles du développement ou de troubles mentaux ont besoin de logements spéciaux. De
petites installations de type familial comme les foyers, capables de dispenser des
services d'appui suffisants – au titre de programmes sociaux visant à aider
certaines personnes à vivre de manière autonome, par exemple – pourrait
répondre à ce besoin de manière judicieuse.
89. Les États devraient faire en sorte
qu'il soit tenu compte de la situation des personnes atteintes de troubles du
développement ou de troubles mentaux dans les travaux de recherche, les activités
statistiques et l'étude des conditions de vie des handicapés.
90. Les États devraient encourager et
appuyer la constitution d'organisations qui défendent les intérêts des personnes
atteintes de troubles du développement ou de troubles mentaux, y compris les
organisations composées de personnes entrant dans cette catégorie ou de leurs parents.
N. Handicaps invisibles
91. Un nombre important de handicapés
sont atteints de handicaps qui ne sont pas aisément décelables, ce qui est souvent à
l'origine de malentendus. Font notamment partie de ce groupe les personnes atteintes de
troubles du développement ou de troubles mentaux et de maladies chroniques, les
malentendants et les sourds.
92. Il importe que les programmes de
sensibilisation tiennent compte de ces personnes et des problèmes particuliers auxquels
elles peuvent devoir faire face.
93. Il importe également de tenir
compte des caractéristiques particulières des handicaps invisibles lorsque des mesures
sont prises en vue de donner aux handicapés la possibilité de participer pleinement à
la vie sociale, dans des conditions d'égalité.
O. Nouvelles propositions concernant les politiques et législations
nationales
94. Compte tenu de l'expérience
acquise depuis un certain nombre d'années dans l'application des Règles et de
l'évolution qui s'est produite dans le domaine des droits de l'homme, des recommandations
générales applicables aux politiques des gouvernements peuvent être formulées :
a) Les États devraient adopter des lois
antidiscriminatoires contraignantes qui abolissent les obstacles à la participation des
handicapés à la vie collective dans des conditions d'égalité. Ils devraient veiller à
cet égard à ce que des personnes handicapées faisant partie de populations autochtones
et d'autres minorités soient associées à cette entreprise;
b) Les États devraient envisager d'adopter des lois
qui rendent obligatoire la fourniture, aux handicapés et aux membres de leur famille qui
en ont besoin, d'appareils et accessoires fonctionnels, d'une assistance personnelle et de
services d'interprète, ce qui serait un bon moyen de promouvoir l'égalité des chances;
c) Les États devraient envisager de se servir des
marchés publics comme d'un moyen d'assurer l'accessibilité. La conception et la
construction d'édifices et d'équipements collectifs devraient être assujetties aux
normes en matière d'accessibilité dès les premiers stades;
d) Les États devraient envisager d'adopter des
mesures législatives qui encouragent et favorisent l'accessibilité aux systèmes de
transport, aux logements et aux services d'information et de communication;
e) Les États devraient appuyer et promouvoir les
échanges internationaux de résultats de recherches et de données d'expérience et la
diffusion des meilleures pratiques dans tous les secteurs de la société;
f) Les États devraient prendre les mesures
requises pour qu'il soit rendu compte de la situation des handicapés dans leurs rapports
périodiques aux comités chargés de suivre l'application des conventions relatives aux
droits de l'homme auxquelles ils sont parties, même lorsque ces conventions ne se
réfèrent pas spécifiquement aux handicapés. Ils devraient encourager les organisations
de handicapés à faire état de leurs vues lors de l'examen des rapports et les appuyer
dans cette entreprise;
g) Avant d'adopter des politiques, des programmes et
des lois de nature à modifier les conditions de vie de la population en général, les
États devraient en évaluer les conséquences possibles pour les handicapés.
Haut de page |