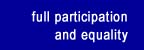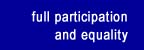PROGRAMME DACTION MONDIAL CONCERNANT LES
PERSONNES HANDICAPÉES
2/10   
OBJECTIFS, HISTORIQUE ET CONCEPTS
- Prévention
- Réadaptation
- Egalisation des chances
Prévention
Une stratégie de la prévention est indispensable pour réduire l'incidence des
déficiences et invalidités. Les principaux éléments de cette stratégie, qui varieront
suivant le stade de développement du pays en question, sont les suivants :
a) Les principales mesures de prévention des déficiences sont les suivantes :
prévention de la guerre, amélioration de la situation culturelle, économique et sociale
des groupes les plus défavorisés; identification des types de déficiences et de leurs
causes par zone géographique; adoption de mesures spécifiques d'intervention grâce à
l'amélioration des pratiques nutritionnel-les et des services de santé; dépistage et
diagnostic précoces; soins prénatals et post-natals; directives en matière de soins de
santé, y compris l'éducation des patients et des médecins, plani-fication de la
famille; législation et réglementation; modifica-tion des modes de vie; services de
placement sélectif; éducation en matière de risques de l'environnement; action en
faveur d'une meilleure information et d'une consolidation des familles et des
collectivités.
b) A mesure que les pays se développent, les risques an-ciens s'estompent, alors que
de nouveaux apparaissent. Cette évolution de la situation appelle une réorientation des
stratégies, par exemple programmes d'intervention nutritionnelle orientés vers les
besoins de groupes spécifiques de population les plus menacés en raison de carence de
vitamine A, une amélioration des soins médicaux aux personnes âgées, l'exécution
d'activités de formation et l'adoption de règlements en vue de réduire les accidents du
travail dans l'industrie et dans l'agriculture, les accidents de la circulation et les
accidents au lieu de résidence, et sur la lutte contre la pollution et contre l'usage et
l'abus des drogues et de l'alcool. Dans ce contexte, il conviendrait d'accorder au
programme de l'OMS "La santé pour tous d'ici l'an 2000" grâce aux soins de
santé primaires l'attention voulue.
Il convient de prendre des mesures pour dépister le plus tôt possible les symptômes
et signes de déficiences et entreprendre immédiatement une action curative ou
corrective, qui peut prévenir l'incapacité ou du moins contribuer à en réduire
sensiblement la gravité et, souvent, empêcher qu'elle ne devienne permanente. Pour la
détection précoce, il est important d'assurer aux familles une éducation et une
information adéquates, ainsi que la fourniture d'une assistance technique par les
services médicaux et sociaux.
Réadaptation
En général, la réadaptation comprend la prestation des services énumérés
ci-après :
a) Dépistage, diagnostic et intervention précoces;
b) Soins et traitements médicaux;
c) Assistance et conseils d'ordre social, psychologique et autre;
d) Formation à l'auto-assistance - mobilité, communication, vie quotidienne - avec
adoption de dispositions spéciales pour les malentendants et les malvoyants, les
arriérés mentaux etc;
e) Fourniture d'auxiliaires techniques, d'appareils favorisant la mobilité et d'autres
dispositifs;
f) Services d'enseignement spécialisés;
g) Services de réinsertion professionnelle (y compris orientation professionnelle),
formation professionnelle et placement sélectif;
h) Observation ultérieure.
Lors de la réadaptation, l'accent devrait toujours être mis sur les aptitudes des
intéressés et respecter la totalité de leur per-sonne et leur dignité. Il faut veiller
tout particulièrement à ce que les enfants handicapés puissent se développer et
s'épanouir normalement. Il faudrait utiliser la capacité de travailler et d'ac-complir
d'autres activités des adultes handicapés.
La famille et la communauté peuvent jouer un grand rôle dans la réadaptation des
personnes handicapées. Il ne faut ménager aucun effort pour aider ces personnes à
maintenir la cohésion de leur famille, leur permettre de vivre dans leur com-munauté
d'origine et soutenir les familles et les groupes commu-nautaires qui travaillent dans ce
sens. En planifiant la réadapta-tion et les programmes d'appui, il est indispensable de
prendre en considération les coutumes et les structures familiales et communautaires et
d'apprendre aux familles et aux commu-nautés à mieux répondre aux besoins des personnes
handi-capées.
Les services destines aux personnes handicapées devraient, dans la mesure du possible,
être fournis dans le cadre des structures existantes en matière sociale et sanitaire
ainsi que dans le domaine de l'enseignement et du travail : soins hospi-taliers à tous
les niveaux, enseignement primaire, secondaire et supérieur, programmes généraux de
formation professionnelle et de placement, sécurité sociale et services sociaux. Les
services de réadaptation ont pour objectif de faciliter aux personnes handicapées la
participation aux services et activités normaux de la communauté. La réadaptation
devrait se faire dans l'envi-ronnement naturel des intéressés, avec l'appui de services
com-munautaires et d'établissements spécialisés. Il faudrait éviter les grands
établissements. Les établissements spéciaux, lorsqu'ils sont nécessaires, devraient
être organisés de manière à assurer une intégration rapide et durable des personnes
handicapées dans la société.
Les programmes de réadaptation devraient permettre aux personnes handicapées de
participer à la création et à l'organi-sation de services qu'eux-mêmes et leurs
familles jugent néces-saires. Le sys~èn1.e devrait prévoir la participation des
personnes handicapées à la prise de décisions relatives à leur réadaptation.
Lorsqu'elles ne sont pas en mesure de participer comme il convient aux décisions qui les
intéressent - par exemple en cas de déficience mentale grave - des membres de leur
famille ou des représentants désignés légalement devraient pouvoir le faire à leur
place.
Il convient de redoubler d'efforts pour créer des services de réadaptation qui soient
intégrés dans d'autres organismes et pour les rendre plus accessibles. Ils ne devraient
pas être tributaires d'installations, de matières premières et de techniques coûteuses
et importées. Il faut encourager les transferts de techniques entre pays et donner la
préférence à des méthodes fonctionnelles adaptées aux besoins locaux.
Egalisation des chances
Pour que soit atteint l'objectif "pleine participation et égalité", il ne
suffit pas de prendre des mesures de réadaptation en faveur des personnes handicapées.
L'expérience montre que c'est, dans une large mesure, l'environnement qui détermine les
conséquences d'une déficience ou d'une invalidité sur la vie quotidienne d'un individu.
Une personne est handicapée lorsqu'elle ne peut pas profiter des services offerts à
l'ensemble de la communauté dans les domaines essentiels de l'existence : vie familiale,
enseignement, emploi, logement, sécurité financière et personnelle, participation aux
activités de groupes sociaux et politiques, activités religieuses, relations intimes et
sexuelles, accès aux installations publiques, liberté de mouvement et vie quotidienne en
général.
Certaines sociétés ne s'occupent que des individus qui sont en pleine possession de
tous leurs moyens physiques et mentaux. Elles doivent se rendre compte qu'il y aura
toujours malgré les efforts de prévention - un certain nombre de personnes atteintes de
déficiences et d'incapacités, et étudier et lever les obstacles à leur pleine
participation. Ainsi, lorsque c'est pédagogiquement possible, les personnes handicapées
devraient pouvoir fréquenter les établissements d'enseignement ordinaires, trouver
directement un emploi, et se loger comme l'ensemble de la population. Tous les
gouvernements ont le devoir de veiller à ce que les personnes handicapées profitent
elles aussi des avantages découlant des programmes de développement. Les mesures en ce
sens devraient être incorporées dans le processus général de planification et incluses
dans la structure administrative de la société. Les services supplémentaires
éventuellement nécessaires aux personnes handicapées devraient, dans toute la mesure
possible, être intégrés à l'ensemble des ser-vices assurés au plan national.
Les remarques qui précèdent ne s'appliquent pas seule-ment aux gouvernements. Tout
responsable d'une activité quel-conque doit en assurer également l'accès aux
handicapés. Cela vaut pour les organismes publics à divers niveaux, pour les
or-ganisations non gouvernementales, pour les entreprises et pour les particuliers. Et
cela vaut aussi à l'échelon international.
Les personnes invalides, qui ont besoin de services com-munautaires, de matériels et
d'installations pour pouvoir mener une existence aussi normale que possible, tant à leur
domicile que dans le cadre plus large de la communauté, devraient y avoir accès. Les
personnes qui cohabitent avec ces invalides et les assistent dans leur vie quotidienne
devraient elles-mêmes re-cevoir un soutien, afin de pouvoir jouir du repos et de la
détente nécessaires et se consacrer à leurs propres activités.
Le principe de l'égalité des droits des personnes handi-capées et des personnes non
handicapées implique que les be-soins de chaque individu sont d'égale importance, que
ces be-soins doivent être pris en considération dans la planification de nos sociétés
et que toutes les ressources doivent être mises en œuvre pour assurer à tous les
individus une participation égale. La politique suivie en matière d'invalidité doit
garantir l'accès à tous les services collectifs.
Si les personnes handicapées ont les mêmes droits que les autres, elles ont aussi les
mêmes obligations. Elles ont le devoir de participer à l'édification de la société.
La collectivité doit faire davantage fond sur les personnes handicapées et mobiliser
leurs aptitudes pour apporter des changements sur le plan social, c'est-à-dire notamment
fournir aux jeunes handicapés des possibilités d'emploi et d'instruction, au lieu de
pensions de retraite anticipée ou d'une assistance publique.
Il devrait être entendu que les personnes handicapées sont censées jouer leur rôle
dans la société et remplir les obligations qui incombent aux membres adultes de la
collectivité. Leur image dépend de divers éléments qui déterminent l'attitude de la
société à leur égard et qui pourraient bien constituer le principal obstacle à la
participation et à l'égalité. Nous voyons l'incapa-cité, la canne blanche, les
béquilles, la prothèse auditive et le fauteuil roulant, mais nous ne voyons pas l'être
humain. Ce qu'il faut, c'est axer l'attention sur les capacités des personnes
handicapées, et non sur leurs incapacités.
Partout dans le monde, les personnes handicapées ont commencé à se réunir en
organisations pour défendre leur droit d'exercer une influence sur les responsables, au
niveau des gouvernements et dans tous les secteurs de la société. Ces organisations ont
pour rôle notamment de faire entendre leur voix, de définir les besoins, de donner des
avis sur les ordres de priorité, d'évaluer les services existants, de préconiser des
changements et d'informer le grand public. Instruments d'auto développement, elles sont
le moyen de développer les compétences en matière de négociation et d'organisation, le
soutien mutuel et l'échange d'informations et, souvent aussi, les qualifications et
débouchés professionnels. Etant donné leur importance capitale dans le processus de
participation, il est indispensable de stimuler leur développement.
Les infirmes mentaux commencent maintenant à exiger de pouvoir s'exprimer et
s'efforcent de faire reconnaître leur droit à participer aux prises de décisions et aux
débats. Même ceux dont les facultés de communication sont limitées ont montré qu'ils
pouvaient exprimer leur point de vue. A cet égard, ils ont beaucoup à apprendre des
mouvements de défense des intérêts des personnes atteintes d'autres formes
d'incapacité. Il faut encourager cette tendance.
Pour améliorer la situation des personnes handicapées, il est indispensable de
rassembler et de diffuser des renseignements. Il faudrait s'assurer la coopération de
tous les moyens d'information pour faire mieux comprendre les droits des personnes
handicapées au public et aux intéressés eux-mêmes et lutter ainsi contre les
stéréotypes et les préjugés traditionnels.
|