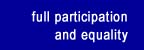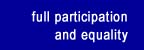PROGRAMME DACTION MONDIAL CONCERNANT LES
PERSONNES HANDICAPÉES
5/10  

SITUATION ACTUELLE
Egalisation des chances
C'est essentiellement par des mesures politiques et sociales que l'on assure aux
personnes handicapées le droit de participer à la vie de leur société.
De nombreux pays ont pris des mesures importantes pour éliminer ou réduire les
obstacles à l'intégration. Des lois ont été adoptées afin de garantir en droit et en
fait l'accès des personnes handicapées à l'enseignement, à l'emploi et aux
installations collectives, d'éliminer les obstacles culturels et matériels et
d'in-terdire toute discrimination. On s'oriente vers l'intégration dans un milieu
communautaire, de préférence au placement dans un établissement spécialisé. De plus
en plus, les pays industrialisés et les pays en développement adoptent un "système
ouvert" d'enseignement, ce qui enlève de l'importance aux établisse-ments et
écoles spécialisés. On a mis au point des façons de ren-dre les transports publics
accessibles et de donner aux handi-capés sensoriels accès à l'information. La
nécessité de prendre de telles mesures est de plus en plus reconnue. Des campagnes
d'éducation et d'information du public ont été lancées dans de nombreux pays afin
d'amener la population à modifier son atti-tude et son comportement à l'égard des
personnes handicapées.
Ce sont souvent les personnes handicapées elles-mêmes qui ont entrepris de mieux
faire comprendre le processus de l'égalisation des chances et qui ont plaidé en faveur
de leur inté-gration dans la vie de la société.
En dépit de ces efforts, les personnes handicapées sont foin d'être parvenues à
avoir des chances égales et leur degré d'inté-gration dans la société est, dans la
plupart des pays, loin d'être satisfaisant.
1.Enseignement
Au moins 10 p. 100 des enfants sont handicapés. Ils ont le même droit à
l'enseignement que ceux qui ne le sont pas et ils ont besoin d'une intervention active et
de services spécialisés. Mais, dans les pays en développement, la plupart des enfants
handicapés ne bénéficient pas de ces services spécialisés ni d'un enseignement
obligatoire.
La situation varie considérablement selon les pays; dans certains, les personnes
handicapées peuvent atteindre un niveau d'instruction élevé; dans d'autres, elles ont
des possibilités limitées ou inexistantes.
On se rend encore mal compte des possibilités des person-nes handicapées. En outre,
il n'y a souvent aucune loi qui traite de leurs besoins et du manque de personnel
enseignant et de moyens d'enseignement. Dans la plupart des pays, les personnes
handicapées n'ont pas encore accès a l'éducation permanente.
On a observé des progrès sensibles en matière de techni-ques pédagogiques et des
innovations importantes dans le domaine de l'enseignement spécialisé et il est possible
d'aller en-core beaucoup plus loin. Mais les progrès sont le plus souvent limités à
quelques pays ou à quelques centres urbains.
Ces progrès portent sur le dépistage, l'évaluation et l'inter-vention précoces et
sur les programmes d'enseignement spécialisé dispensés dans des conditions
différentes, car si de nombreux enfants handicapés peuvent fréquenter l'école
normalement, d'autres ont besoin de programmes très intensifs.
2. Emploi
Il est fréquent que les personnes handicapées ne soient pas embauchées ou se voient
seulement confier des emplois subal-ternes et mal rémunérés. Il est pourtant possible
de démontrer que, bien aiguillées, bien formées et correctement placées, la plupart
d'entre elles peuvent exécuter une grande variété de tâches conformément aux normes
en vigueur. En période de chômage et de crise économique, elles sont généralement les
premières à être licenciées et les dernières à être embauchées. Dans certains pays
industrialisés frappés par la récession, le taux de chômage est deux fois plus élevé
chez les personnes han-dicapées que chez les personnes valides. Dans de nombreux pays,
divers programmes ont été élaborés et des mesures prises pour créer des emplois pour
les personnes handicapées : ateliers protégés, enclaves protégées, postes réservés,
systèmes de quotas, subventions aux employeurs qui forment puis recrutent des
travailleurs handicapés, coopératives formées de personnes handicapées ou à leur
intention etc. Le nombre des personnes handicapées employées dans des établissements
normaux ou spécialisés est bien inférieur à celui des personnes handicapées capables
de travailler. En appliquant plus largement les princi-pes d'ergonomie, on peut adapter
les ateliers, les outils, les machines et le matériel à relativement peu de frais, ce
qui multi-plie les possibilités d'emploi pour les personnes handicapées.
Un grand nombre de personnes handicapées, en particu-lier dans les pays en
développement, vivent dans des zones rurales. Lorsque l'économie familiale repose
essentiellement sur l'agriculture ou d'autres occupations rurales et que la famille
élargie de type traditionnel existe, il est le plus souvent possible de confier aux
personnes handicapées certaines tâches utiles. A mesure que le nombre de familles
abandonnant les zones rurales pour les centres urbains s'accroît, que l'agriculture se
mécanise et devient plus commerciale, que les transactions monétaires remplacent le
commerce de troc et que la famille élargie se désintègre, la situation des personnes
handicapées sur le plan de 1 'emploi se détériore. Dans les taudis urbains, la
con-currence sur le plan de l'emploi est sévère et les autres activités économiquement
productives sont rares. Beaucoup de person-nes handicapées souffrent de cette oisiveté
forcée et deviennent dépendantes; d'autres doivent recourir à la mendicité.
3. Aspects sociaux
La pleine participation aux éléments fondamentaux de la société - famille, groupe
social et communauté - est à la base même de l'expérience humaine. Le droit à cette
participation, à égalité de chances, est énoncé dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme et devrait être le même pour tous, y com-pris les personnes
handicapées. En fait, celles-ci se voient sou-vent refuser la possibilité de participer
pleinement aux activités dans leur système socio-culturel. Cette situation est due aux
obstacles matériels et sociaux nés de l'ignorance, de l'indiffé-rence et de la peur.
Souvent, les personnes handicapées sont exclues de la vie sociale et culturelle à
cause de certaines attitudes. Les gens ten-dent à éviter les contacts et les relations
personnelles avec les personnes handicapées. Pour bon nombre d'entre elles, les
pré-jugés et la discrimination dont elles sont fréquemment victimes et la conscience
d'être tenues à l'écart des relations sociales nor-males sont une source de problèmes
psychologiques et sociaux.
Trop souvent, le personnel des services avec lesquels les personnes handicapées ont
affaire ne se rend pas compte que celles-ci peuvent participer à la vie sociale normale
et, de ce fait, ne facilite pas leur intégration à d'autres groupes sociaux.
En raison de ces obstacles, il est souvent difficile, voire im-possible, aux personnes
handicapées d'entretenir des relations étroites et intimes avec les autres. Le mariage
et la procréation sont souvent hors de question pour qui est catalogué comme
"personne handicapée", même si aucun facteur physiologique ne s'y oppose. On
reconnaît davantage aujourd'hui que les han-dicapés mentaux ont besoin d'entretenir des
relations person-nelles et sociales et notamment d'avoir des relations sexuelles.
Bien des personnes handicapées sont non seulement exclues de la vie sociale normale de
leur communauté mais se trouvent, en l'ait, recluses dans des institutions. Si les
léprose-ries d'autre fois ont généralement disparu et si les asiles d'aliénés sont
moins nombreux que jadis, beaucoup trop de personnes sont actuellement Internées alors
que rien, dans leur état, ne le justifie.
Bien des personnes handicapées ne peuvent prendre une part active à la vie de la
-société cri raison d'obstacles matériels divers : portes trop étroites pour permettre
le passage des fau-teuils roulants, marches empêchant l'accès aux immeubles, aux
autobus, aux trains et aux avions, téléphones et interrupteurs électriques hors de
portée, installations sanitaires inutilisables pour certaines personnes handicapées. De
même, leur isolement peut tenir à d'autres obstacles : il n'est pas tenu compte des
be-soins des malentendants dans les communications orales ni de ceux des malvoyants dans
la diffusion de l'information par l'écriture. Ces obstacles sont dus à l'ignorance et à
l'indiffé-rence; pourtant la plupart d'entre eux permettraient d'éliminer à peu de
frais une planification soigneuse. Bien que certains pays aient adopté des lois et lancé
des campagnes pour l'éducation du public afin d'éliminer ces obstacles, le problème
reste crucial.
En règle générale, il existe un lien étroit entre les services, les installations
et les mesures sociales pour la prévention de l'infirmité ainsi que pour la
réadaptation des personnes handi-capées et leur insertion dans la société et la
volonté et la capacité des pouvoirs publics et de la société à consacrer des
ressources humaines et financières aux groupes de population défavorisés.
L'invalidité et le nouvel ordre économique international
La mise en œuvre des dispositions relatives au transfert de ressources et de
techniques des pays développés aux pays en développement, qui est prévu dans le nouvel
ordre économique international et les autres dispositions visant à renforcer
l'éco-nomie des nations en développement serait bénéfique aux popu-lations de ces
pays, et notamment aux handicapés. L'améliora-tion de la situation économique des pays
en développement, particulièrement dans leurs zones rurales, fournirait de nouvel-les
possibilités d'emploi pour les personnes handicapées ainsi que les ressources
nécessaires pour financer des mesures en matière de prévention, de réadaptation et
d'égalisation des chances. Bien administré, le transfert de techniques appropriées
pourrait faire naître des entreprises spécialisées dans la produc-tion industrielle de
dispositifs et de matériel propres à remédier aux effets de l'infirmité physique,
mentale ou sensorielle.
Dans la Stratégie internationale du développement pour la troisième Décennie des
Nations Unies pour le développement il est dit que des efforts particuliers devraient
être faits pour inté-grer les personnes handicapées au processus de développement et
que des mesures efficaces de prévention, de réadaptation et d'égalisation des chances
sont donc indispensables. Toute mesure positive en ce sens s'inscrirait dans le contexte
de l'effort général fourni en vue de mobiliser toutes les ressources humaines au service
du développement. La transformation de l'ordre économique international devra aller de
pair avec l'adoption par les pays de réformes visant à assurer la pleine participation
des groupes de population défavorisés.
Conséquences du développement économique et social
Dans la mesure où les efforts de développement permet-tent d'améliorer la nutrition,
l'enseignement, le logement et les conditions sanitaires et d'offrir des soins de santé
primaires ap-propriés, les possibilités de prévention des infirmités et de traite-ment
des invalidités sont bien meilleures. Des progrès dans ce sens peuvent aussi être
facilités notamment par les mesures sui-vantes :
a) Format ion de personnel dans des domaines généraux, tels que l'assistance sociale,
la santé publique, la médecine, l'en-seignement et la réadaptation professionnelle;
b) Accroissement des capacités de production locale du matériel et des équipements
nécessaires aux personnes handi-capées;
c) Création de services sociaux, de systèmes de sécurité sociale, de coopératives
et de programmes d'assistance mutuelle aux niveaux national et communautaire;
d) Création de services adéquats d'orientation profes-sionnelle et de préparation au
travail, ainsi que l'augmentation du nombre des emplois pour les personnes handicapées.
Toutefois, comme le développement économique entraîne des modifications dans
l'importance et la répartition de la popu-lation, ainsi qu'une évolution du style de
vie, des structures et des rapports sociaux, l'amélioration et le développement des
services nécessaires pour faire face aux problèmes humains ne sont en général pas
assez rapides. Ces déséquilibres entre les as-pects économiques et sociaux du
développement rendent encore plus difficile l'intégration des personnes handicapées
dans leurs communautés.
|