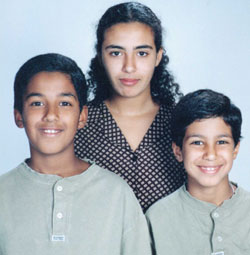LES ENFANTS INTERNATIONAUX
des catalyseurs du changement
Par Dorothy Davis
 Imprimer
Imprimer |
| Page d'accueil | Dans ce numéro | Archives | Anglais | Contactez-nous | Abonnez-vous | Liens |
| L'article | ||||
|
Quand son père a été nommé Chargé
d'affaires à la Mission de Djibouti, Dounia Dorani et sa
famille sont allés vivre en Arabie saoudite. Elle avait un
an. Nee à Djibouti, elle était trop jeune pour connaître
son pays d'origine avant d'être immergée dans la culture
saoudienne. Le travail de son père a fait d'elle une enfant
internationale - l'incarnation de la vision de son travail ainsi
que des autres fonctionnaires civils internationaux.
Son frère cadet, Seif, est également né à Djibouti et le plus jeune, Anas, à New York. Comme c'est souvent le cas des enfants internationaux, les questions " Où es-tu né ? " et " Pourquoi es-tu né là ? " donnent lieu à des réponses non conventionnelles. Cependant, la question fondamentale qu'ils se posent, parfois toute leur vie, est : " En dehors de ma famille immédiate et des familles comme la mienne, où est ma place ? " Ces questions que se posent les enfants de fonctionnaires internationaux comme moi me sont familières. Je fais partie de la première génération d'enfants qui a voyagé dans le monde suite à la création des Nations Unies, après les mouvements d'indépendance dans le monde et les mouvements des droits civils aux États-Unis. Je suis née dans une maternité à Monrovia, au Liberia, de parents américains, qui travaillaient au service diplomatique des États-Unis. Contrairement aux autres femmes qui sont rentrées dans leur pays pour accoucher, ma mère a fait confiance aux Libériens, même quand il y a eu des complications. Même si je suis citoyenne américaine de naissance, mon identité a toujours été la somme de mes expériences, n'apercevant pas le monde qui m'entourait à travers un écran culturel américain. D'un autre côté, mes parents ont pu devenir adultes dans une culture avant de se consacrer à la diplomatie. À cet égard, j'ai été élevée comme Dounia, bien qu'une génération nous sépare et que nous venions de pays différents. Puisque le Liberia est mon point d'entrée dans le monde, il est devenu inconsciemment l'étalon à l'aune duquel j'ai mesuré les cultures et les points de vue durant les quatre années passées aux postes suivants : en Tunisie, nouvellement indépendante, aux États-Unis, du début jusqu'au milieu des années 60, et au Nigeria, alternant des étés et des vacances au Liberia et aux États-Unis, tout en poursuivant mes études à l'école internationale de Genève. Toutes ces expériences ont enrichi ma vie avant que je ne m'installe à 17 ans de manière plus permanente dans mon pays de citoyenneté - les États-Unis - au plus fort de la révolution socioculturelle des années 1970. Comment un enfant international passe-t-il d'une culture à l'autre ? D'abord, la plupart d'entre nous développent inconsciemment la faculté de recevoir et d'interpréter les données culturelles et les signaux qui nous entourent et d'y répondre. Cela constitue donc notre technique de survie première et inhérente - avec ou sans nos familles pendant les années de formation, c'est-à-dire de l'enfance à la fin de l'adolescence - ce qui nous est très familier et très étranger, y compris dans notre pays de citoyenneté. " Djibouti est mon pays. L'Amérique est mon pays de résidence ", explique Dounia. " Je n'ai pas eu de véritable enfance dans ce pays. Les souvenirs remontent à mon enfance et mon enfance s'est déroulée ici ", souligne-t-elle. On construit sur ce que l'on sait et on devient les interprètes de ce que l'on apprend. " J'ai appris à ne pas juger immédiatement une personne ", explique Anas, 15 ans. " Je me souviens de ce nouveau venu qui voulait se joindre à l'équipe de foot. Il était à moitié nigérien, à moitié chinois. Mes copains pensaient qu'il ne savait pas jouer. Je leur ai dit de lui donner une chance et de l'accepter dans l'équipe. Il est devenu meilleur qu'eux et ils ne peuvent plus rien dire contre lui maintenant. " Anas a connu une période très difficile après le 11 septembre (2001). " Mes copains de Roosevelt Island savaient que j'étais musulman. Après le 11 septembre, ils étaient sûrs que tous les musulmans étaient des terroristes. Sur le terrain de foot, ils se liguaient contre mon frère et moi parce que nous étions musulmans. Ils nous sanctionnaient toujours sans raison. Nous avons traversé une période difficile. Nos copains ont fini par revenir. "
Il se souvient aussi des difficultés de son frère aîné, Seif, à s'assimiler. " Chaque fois qu'il voulait jouer, les autres enfants s'en prenaient à lui. Il se bagarrait. Le jour suivant, il sortait et agissait comme si rien ne s'était passé, et la même chose se produisait. À huit ans, il a pris des cours de karaté. Cela lui a appris la discipline, le respect et la tolérance ", explique-t-il. " Mon frère est maintenant ceinture noire deuxième dan. Je marche sur ses traces et suis ceinture noire junior première dan. Grâce au sport, nous avons appris à inspirer le respect. " En tant qu'enfants internationaux, notre famille immédiate est dépositaire de nos souvenirs et de nos expériences. Quand nous parlons de ces expériences avec les autres membres de notre famille et nos amis, très souvent, nous ne partageons pas les mêmes points de vue car nous avons été exposés à un environnement international et avons vécu dans le cadre national de nos pays d'origine ou d'accueil. Cela cause une certaine incompréhension qui nous force à trouver des moyens pour combler l'écart. La seule chose qui nous soit familière, c'est le contenu de nos valises et la routine de notre vie de nomade. Et, une fois les valises déballées, nous pouvons commencer en toute confiance le processus d'assimilation. La vie des enfants internationaux, une fois installés dans leur nouveau pays, peut être perturbée quand leurs parents sont envoyés, sans eux, en mission dans un autre pays. Dans mon cas, la guerre du Biafra a éclaté six mois après que mon père était en poste au Nigeria. Mon frère et moi avons été finalement autorisés à lui rendre visite pendant les vacances scolaires, mais nous n'avons pas pu aller à l'école à Lagos parce que l'école américaine était située à côté d'une garnison de l'armée. Dans le cas de Dounia et de ses frères, leur père est entré aux Nations Unies en avril 1997 et a été immédiatement transféré à Bakou, en Azerbaïdjan, pendant quatre ans, dans un lieu d'affectation déconseillé aux familles, puis au Caire, en Égypte, pendant quatre autres années dans un lieu d'affectation avec famille. Mais les enfants étant des adolescents et ne voulant pas quitter leurs amis et la vie qu'ils avaient construite à New York, ils rendaient visite à leur père pendant les vacances scolaires. En 2005, M. Dorani a été transféré au siège de l'ONU et a retrouvé sa famille. Cette expérience de vie amène les enfants internationaux à redéfinir la richesse, non pas en termes d'accumulations de biens mais en termes de rencontres, de perspectives et d'amitié. Pourtant, à moins d'avoir des ressources indépendantes, il est impossible de reproduire ce style de vie avec le salaire moyen que touchent les fonctionnaires internationaux de retour dans leur pays d'origine. Ce sont les paradoxes auxquels nous sommes confrontés et que nous devons expliquer à notre famille élargie et à nos amis qui n'ont pas connu la même chose. Quand on s'est aperçu qu'elle avait des problèmes d'apprentissage, Dounia a été envoyée à la Winston Preparatory School. " Cette école, située dans un quartier riche, accueillait plus d'enfants blancs. Il n'y avait pas autant de diversité que dans les écoles précédentes. Les filles que je côtoyais avaient de l'argent, mais aucune ambition ni aucune compréhension de l'histoire et de la culture ", commente-t-elle. Elle se souvient d'une amie à qui les parents donnaient beaucoup d'argent et achetaient tous les vêtements et les bijoux qu'elle voulait, mais qui était quand même malheureuse et a eu, plus tard, un problème de drogue. Reconnaissant l'impact négatif que pouvait avoir cette relation, elle a mis fin à leur amitié. Elle a aussi compris qu'être riche ne signifiait pas que posséder une richesse matérielle. Résumant son parcours, Dounia dit : " Je ne savais pas qui j'étais avant d'aller à l'université. Pour la première fois, j'ai dû prendre des décisions et faire mes propres choix. Je sais maintenant la valeur de ce que j'ai vécu. Il suffit parfois d'une personne pour tout changer. Il faut toujours aider ceux qui vous ont encouragé parce que quand vous revenez, vous pouvez aider leurs enfants. Cela permet de briser le cycle de la pauvreté, de l'ignorance et de la dépendance. Une voix peut faire la différence. " Les leçons que nous avons apprises dans notre vie d'enfants internationaux sont indélébiles et nous guident tout au long de notre vie. Elles nous font involontairement les catalyseurs du changement, nous forçant à redéfinir le sens traditionnel de ce que nous devrions être, tout en laissant ceux qui nous entourent être eux-mêmes. |
| Biographie |
 Dorothy
Davis est fondatrice et présidente de The Diasporan Touch,
une société de conseil spécialisée dans
le développement des communications et de soutien aux célébrités,
principalement pour la diaspora africaine. Elle a été
responsable du Programme des ambassadeurs itinérants du Programme
des Nations Unies pour le développement et a été
directrice des affaires publiques à l'Institut Afrique-Amérique. Dorothy
Davis est fondatrice et présidente de The Diasporan Touch,
une société de conseil spécialisée dans
le développement des communications et de soutien aux célébrités,
principalement pour la diaspora africaine. Elle a été
responsable du Programme des ambassadeurs itinérants du Programme
des Nations Unies pour le développement et a été
directrice des affaires publiques à l'Institut Afrique-Amérique. |
| Page d'accueil | Dans ce numéro | Archives | Anglais | Contactez-nous | Abonnez-vous | Liens |
|
|