 |
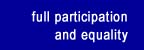 |
|
 |
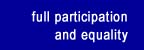 |
|
United Nations
|
Les indicateurs sont des données qui sont censées mesurer au mieux les progrès réalisés alors que le contrôle s'inscrit dans le cadre de la démarche consistant à fixer des buts et objectifs et à établir ensuite des critères d'évaluation afin de déterminer si les objectifs ont été atteints et si les critères ont été observés. |
Comme il est indiqué plus haut, les recensements nationaux représentent une source importante de données sur les incapacités pour de nombreux pays. Depuis 1980, au moins 12 pays ont fourni des tableaux sur l'éducation et 15 pays ont présenté des tableaux sur les variables de l'emploi. Deux pays, Chypre et la Zambie, disposent de données sur l'éducation et l'emploi provenant de deux recensements, tandis que la Tunisie possède des statistiques sur l'emploi provenant de deux recensements.
De nombreux pays ont réalisé des enquêtes et des recensements. Depuis 1992, au moins 36 pays ont incorporé des questions liées aux incapacités dans leur recensement, recueilli des informations à partir d'enquêtes ou obtenu des estimations. On a ainsi pu collecter des informations concernant l'âge et le sexe (17 sources), l'éducation et les variables de la population active (5 sources), le lieu de résidence (zone urbaine ou rurale) (9 sources), la situation de famille (4 sources), la cause de l'incapacité (10 sources) et d'autres aspects (4 sources). Il convient de souligner tout particulièrement le nombre relativement élevé de pays recueillant des informations en matière d'étiologie.
On observe une nette amélioration du taux de couverture. Alors que seul un petit nombre de pays ont défini des indicateurs précis pour mesurer les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs du Programme d'action, de plus en plus de données concernant les domaines cibles des Règles sont recueillies et publiées. Si peu de progrès ont été enregistrés en matière de collecte de données pour les indicateurs concernant l'environnement et certains aspects de la vie, la situation des indicateurs des résultats d'ensemble paraît, en revanche, prometteuse.
Les organisations internationales ont pris des initiatives en vue d'améliorer le contrôle des incapacités chez les enfants. L'OMS et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) sont parvenus à un accord concernant les indicateurs de contrôle des objectifs de santé du Sommet mondial pour les enfants. Afin de contrôler les progrès enregistrés vers la réalisation de l'objectif de l'amélioration de la protection des enfants vivant dans des conditions particulièrement difficiles, deux indicateurs généraux ont été proposés. Ils portent sur : a) le nombre total de personnes souffrant d'incapacités d'une durée de six mois; b) le taux d'incapacité total pour 1 000 enfants. Les catégories d'incapacités concernent la vue, l'ouïe et la parole, le déplacement, l'apprentissage et la compréhension, le comportement et les autres incapacités. Ces catégories sont ventilées par groupe d'âge (moins de 5 ans, 5-14 ans, 15-19 ans et plus de 20 ans), par sexe et par lieu de résidence (zone rurale ou urbaine). La couverture récente des services de rééducation figure parmi les autres indicateurs envisagés. L'OMS a intégré ces questions dans ses indicateurs généraux de programme.
L'OMS et la Banque mondiale ont également travaillé de concert en vue de mettre au point des indicateurs de la qualité de la vie rapportés au nombre d'années de vie. Cette initiative a parfois été l'objet de controverse parce qu'elle place l'incapacité au même rang que le décès, et que les estimations se fondent sur des estimations cliniques de prévalence, contrairement aux informations obtenues par DISTAT.
Les indicateurs examinés jusqu'à présent semblent être, d'une certaine manière, davantage orientés vers les objectifs de prévention et de réinsertion que d'égalisation des chances.
Les indicateurs examinés jusqu'à présent semblent être, d'une certaine manière, davantage orientés vers les objectifs de prévention et de réinsertion que d'égalisation des chances. Bien que peu d'indicateurs officiels aient été établis dans ce domaine, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) participe à un processus lancé par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en vue de mettre au point des indicateurs des besoins éducatifs spéciaux. Ce processus pourrait fournir des indicateurs fondés sur les besoins contrairement aux catégories d'incapacités.
La question du nombre de pays couverts revêt une grande importance et devrait être prise en compte par les organisations internationales quand elles recueillent des données en vue d'établir des indicateurs d'égalisation des chances. Quand le Rapporteur spécial sur la situation des handicapés a réalisé sa première enquête à la fin de 1994, seuls 38 gouvernements lui ont fourni des informations. Lors de la deuxième enquête, réalisée à la fin de 1996, ce chiffre est passé à 83, ce qui correspond à 45 % des Etats Membres. Dans le cas de l'étude de l'UNESCO susmentionnée, 70 pays ont reçu une demande d'information, et 52 d'entre eux – soit 74 % - y ont répondu. On dispose de données concernant de nombreux sujets mais il serait de toute évidence souhaitable que les études réalisées couvrent davantage de pays.
Comme cela a été mentionné plus haut, la Division de statistique de l'ONU a réalisé des progrès importants dans la compilation de statistiques sur les incapacités. En définissant des sujets pour les tableaux figurant dans DISTAT et en formulant des recommandations concernant la collecte de données – ces deux démarches étant en conformité avec les Règles – la Division a établi un corps solide de sujets à partir desquels on peut choisir des indicateurs de résultats.
Bien que de nombreux efforts prometteurs soient entrepris pour promouvoir une meilleure intégration des questions liées à l'incapacité lors de l'élaboration de politiques en faveur des personnes handicapées, il reste encore beaucoup à faire en ce qui concerne la mise en œuvre de ces politiques. Il est donc essentiel de s'intéresser de près au suivi de l'application des politiques si l'on veut promouvoir une mise en œuvre véritable de ces politiques d'intégration. Pour qu'une telle intégration soit possible, il convient de mettre l'accent sur l'amélioration des résultats mais aussi sur l'évolution de l'environnement et la facilitation de l'accès, ce qui signifie qu'un suivi est également nécessaire dans ces domaines.40
La question de l'utilisation de données et d'indicateurs comme instruments permettant une mise en œuvre efficace du Programme d'action mérite également d'être examinée. Au moins trois sources de tensions ont été identifiées dans ce domaine :
- entre la volonté de disposer d'un véritable ensemble de normes internationales pour tous les individus et la volonté de respecter les différences nationales et culturelles;
- entre la nécessité de s'adapter aux changements au fil du temps et la nécessité de disposer de données comparables à des moments différents;
- entre la nécessité de disposer des données sur l'accès et l'environnement quand ces données ne sont pas toujours disponibles.
Tout comme cela a été le cas quand il s'est agi de définir l'incapacité, il a été dit que ces problèmes ne devaient pas constituer des obstacles insurmontables mais au contraire être abordés de manière pratique et directe. On pourrait traiter ces problèmes en tenant compte des atouts et des ressources des pays. Cette démarche permet de déceler les problèmes survenant dans l'analyse chronologique des données et pourrait grandement contribuer à la mise au point d'indicateurs.42
Une démarche fondée sur la réalisation d'études de cas a ainsi mis en évidence que les données sur les incapacités pouvaient être recueillies de manière régulière, ce qui a donné naissance à DISTAT. DISTAT est un outil qui a suscité un intérêt en ce qui concerne non seulement les questions liées aux données sur les incapacités mais aussi la question de l'incapacité dans son ensemble. DISTAT a ainsi été utilisée pour sélectionner trois pays devant faire l'objet d'une étude de cas concernant l'analyse chronologique de données sur les incapacités, une initiative qui aurait été pratiquement impossible à réaliser au moment où le Programme d'action a été adopté. Bien qu'elles mettent en exergue certains problèmes, les études de cas montrent cependant que la mise au point de données pour le suivi et d'indicateurs est possible et souhaitable.43
De nombreux phénomènes auront une incidence sur la prévalence des incapacités au sein de la population et sur les personnes ayant des incapacités...
Les données recueillies jusqu'ici indiquent qu'au cours des cinq prochaines années, de nombreux phénomènes auront une incidence sur la prévalence des incapacités au sein de la population et sur les personnes ayant des incapacités. Avec le déclin de la mortalité infantile, des enfants qui seraient morts prématurément vivent plus longtemps. De même, le vieillissement de la population a pour corollaire une augmentation du nombre des personnes âgées souffrant d'incapacités. De nombreuses personnes se retrouveront à devoir prendre soin d'un enfant ou d'une personne âgée ayant des incapacités. Alors que les personnes handicapées grandiront, deviendront adultes et vieilliront, ces phénomènes auront une influence sur leur passage par les différentes étapes de la vie. On peut donc s'attendre à ce que la défense de la cause des personnes souffrant d'incapacités gagne en importance.44
Depuis l'adoption du Programme d'action mondial en 1982, on a souvent utilisé l'estimation établie par l'OMS selon laquelle plus de 500 millions de personnes à travers le monde souffriraient de déficiences et d'incapacités. Les données sur les incapacités brillent par leur absence dans l'examen récent de recueils de données figurant dans certains rapports sur le développement présentés par la Banque mondiale ainsi que par des organes et organismes du système des Nations Unies.45
En outre, en raison des retards enregistrés entre la collecte des données et leur analyse, les sources d'information concernant la population pour la période 1992-1997 étaient peu nombreuses. Ainsi, un rapport élaboré par des consultants pour le Secrétariat de l'ONU, contenant des données concernant l'Australie, le Botswana, la Chine et l'île Maurice sur plusieurs années, entre 1987 et 1991, a confirmé les tendances dégagées par la première version de DISTAT, à savoir que : l'incapacité augmente avec l'âge; les personnes handicapées réussissent moins bien au plan académique que celles qui ne le sont pas; les taux d'activité économique sont moins élevés chez les personnes souffrant d'incapacités. Il est peu probable que les données concernant la population pour la période de l'évaluation puissent être utilisées telles quelles au moment où l'évaluation doit être présentée. Elles peuvent cependant être utilisées ultérieurement et, comme cela est indiqué ci-après, il est possible de procéder à des analyses de tendances à long terme.46
L'idéal serait que les indicateurs soient établis au début d'une période d'examen et d'évaluation, et qu'ils soient assortis de références de base et d'objectifs précis. Les changements se produisant au fil du temps pourraient être examinés à l'aide d'informations ayant fait l'objet d'une analyse pour expliquer les disparités observées entre les objectifs précis et les indicateurs. |
Les tendances suivantes sont observées dans l'évolution des mécanismes de contrôle à l'échelle internationale :
L'idéal serait que les indicateurs soient établis au début d'une période d'examen et d'évaluation, et qu'ils soient assortis de références de base et d'objectifs précis. Les changements se produisant au fil du temps pourraient être examinés à l'aide d'informations ayant fait l'objet d'une analyse permettant d'expliquer les disparités observées entre les objectifs précis et les indicateurs. Cet ensemble d'indicateurs n'était pas disponible pour l'examen et l'évaluation en cours du Programme d'action mondial. Compte tenu du retard enregistré entre la collecte des données et la publication de celles-ci dans le cadre d'un recensement, il est peu probable que les données nécessaires pour fournir des indicateurs des incapacités à partir des recensements de 2000 soient disponibles pour 2002, date à laquelle devrait avoir lieu la quatrième opération d'examen et d'évaluation. Toutefois, les progrès réalisés en matière d'élaboration de statistiques évoqués plus haut forment une base solide pour l'élaboration d'indicateurs à long terme.48
Une nette amélioration a été observée en ce qui concerne l'élaboration des données mais les statistiques permettant des analyses comparatives d'une époque à l'autre et entre différents pays restent insuffisantes. L'élaboration de statistiques relatives aux domaines cibles figurant dans les Règles et au milieu physique dans lequel évoluent les personnes frappées d'incapacité revêt une importance particulière. La coopération technique, la formation et l'échange d'information peuvent jouer un rôle déterminant dans l'élaboration de ces statistiques au niveau national.49
Comme c'est le cas en ce qui concerne les politiques, les programmes et la stratégie de mise en œuvre, il est essentiel que les Nations Unies continuent de jouer un rôle de premier plan en matière de contrôle et d'évaluation du Programme d'action. A cet égard, il importe que la Division de statistique de l'ONU dispose de ressources appropriées lui permettant de mener différentes activités avec les pays, notamment de :
Au fur et à mesure que des statistiques sont disponibles, les pays sont encouragés à avoir recours à la Stratégie à long terme pour le contrôle et l'évaluation. Les organisations regroupant des personnes ayant des incapacités et leur famille devraient participer activement au processus d'élaboration et de mise en œuvre de ces activités d'évaluation. En particulier :
Les Nations Unies jouent un rôle important à cet égard dans la mesure où elles apportent un appui aux activités de contrôle menées au niveau des différents pays, et poursuivent les travaux réalisés dans le domaine de la mise au point de techniques pour les variables de contrôle relatives à l'environnement ainsi qu'à l'accès et à l'autonomisation.
Ainsi, les Nations Unies participent aux activités de contrôle régulier de l'application de la Convention No 159 de l'OIT ainsi que des dispositions de la Déclaration de Salamanque et du Cadre d'action pour les besoins éducatifs spéciaux, et elles contribuent également à la publication des résultats obtenus.51
Au niveau national, la mise au point d'indicateurs des incapacités et l'apport d'un appui pour l'étude quantitative d'ensemble de ces indicateurs revêtent une grande importance. A cet égard :
Les indicateurs doivent être clairement associés à des objectifs à court et moyen termes ainsi qu'à certains instruments juridiques et moyens d'action favorisant l'égalisation des chances. Ces associations souhaitables impliquent que les données administratives relatives aux programmes soient utilisées comme un instrument de contrôle et mises en relation avec les données provenant des recensements et des enquêtes. Il faut traiter de manière franche le problème des sacrifices devant être faits en raison d'un manque de ressources et y trouver une solution. Pour cela, il est nécessaire, d'identifier clairement les types de données utilisées pour l'élaboration d'indicateurs et de disposer d'informations précises concernant leurs atouts et leurs déficiences.53
Les efforts déployés par l’ONU pour suivre, collecter et compiler des données nationales officielles sur les progrès de la mise en œuvre du Programme d’action mondial et les obstacles entravant son application ont permis de dégager quatre problèmes :
Il ne faut pas isoler la collecte des données de l’ensemble des objectifs des programmes des Nations Unies dans les secteurs social et économique. Les solutions retenues pour mieux contrôler l’exécution des programmes, notamment la mise au point d’indicateurs destinés à mesurer et à évaluer les progrès réalisés, doivent viser essentiellement les résultats escomptés dans la poursuite des buts et des objectifs correspondants des programmes. Si la mesure des efforts réalisés fait apparaître certains succès mais que les résultats escomptés ne sont pas atteints, il est impératif d’évaluer les différents facteurs qui déterminent ces résultats. Lorsque les ressources font défaut, il est souvent difficile de mesurer les facteurs environnementaux qui déterminent l’exécution d’un programme et les aspects critiques de la vie, surtout dans un recensement. Le paradoxe est que les mesures permettant de savoir si on a donné aux personnes handicapées la capacité de prendre elles-mêmes des décisions concernant leur vie, d’être maîtres de l’utilisation de leur temps, de planifier la gestion de leurs ressources économiques et d’en décider, et de se préparer aux principaux changements de la vie correspondent à la catégorie d’indicateurs qui permettent d’annoncer si les résultats escomptés sont atteints.
On constate que les informations recueillies sur les personnes handicapées portent généralement sur des sujets où l’on pense que les données sont particulièrement précises et non sur les sujets où elles risquent d’être difficiles à obtenir. |
On constate que les informations recueillies sur les personnes handicapées portent généralement sur des sujets où l’on pense que les données sont particulièrement précises et non sur les sujets où elles risquent d’être difficiles à obtenir. Cette approche s’inscrit souvent dans une perspective de protection sociale plutôt que de développement social, car les données relatives à la prévention et à la réadaptation sont souvent considérées comme plus fiables que les données concernant l’égalisation des chances. La collecte d’informations de cette nature contribue à privilégier l’approche de la protection sociale au lieu de délimiter les domaines qu’il faut aborder pour provoquer un changement social valable. Il faut donc veiller à ce que les priorités concernant la collecte des données ne s’étendent pas à la politique sociale. Ce sont les politiques visant à la fois la participation universelle, l’habilitation des personnes handicapées en tant qu’agents du développement et la promotion des droits de l’homme qui orienteront les décisions relatives aux indicateurs des incapacités.
37 Voir Scott Campbell Brown, "Programme monitoring and
evaluation: the disability perspective in the context of development". Page d'accueil
des Nations Unies, Division des politiques sociales et du développement social. Peut
être consulté à l'adresse suivante :
http://www.un.org/esa/socdev/enable/monitor/dme41.htm; mis à jour le 24 novembre 1999.
38 Voir Scott Campbell Brown, "Development of global disability
indicators".
39 Ibid.
40 Voir Scott Campbell Brown, "Conclusions and
recommendations".
41 Ibid.
42 Ibid.
43 Ibid.
44 Ibid.
45 Voir Scott Campbell Brown, "Options for improving programme
monitoring trends in policies and programmes from the disability perspective".
46 Ibid.
47 Ibid.
48 Voir Scott Campbell Brown, "Conclusions and
recommendations".
49 Ibid.
50 Ibid.
51 Ibid.
52 Ibid.
53 Ibid.
54 A/52/351, para. 48-50.